Face à la menace du braconnage, plusieurs pays africains ont adopté une approche militarisée pour protéger leur biodiversité. Si ces mesures permettent de sécuriser certaines espèces menacées, elles entraînent également des expulsions violentes et des abus envers les populations autochtones. Entre conservation et répression, cette stratégie controversée soulève de nombreuses questions éthiques et politiques.
◆ Une menace pour les populations autochtones
La protection de l’environnement et de la biodiversité en Afrique est de plus en plus marquée par une approche militarisée. Dans de nombreux pays du continent, les gouvernements, souvent avec le soutien d’organisations internationales, recourent à des moyens radicaux pour lutter contre le braconnage et l’exploitation illégale des ressources naturelles. Cependant, cette « militarisation verte » engendre des conséquences dramatiques pour les populations autochtones qui se retrouvent souvent dépossédées de leurs terres et victimes de violences lourdes.
◆ L’exemple du parc de Bouba Ndjida au Cameroun
Le parc national de Bouba Ndjida, situé à la frontière entre le Cameroun, le Tchad et le Soudan, est un terrain de chasse prisé par les braconniers, notamment pour l’ivoire des éléphants. Face à cette menace, le gouvernement camerounais a mis en place une vaste opération militaire baptisée Paix à Bouba Ndjida. Chaque année, ce dispositif mobilise environ 600 soldats, 60 véhicules de combat et uneunité d’élite de l’armée. Ce déploiement, coûtant près de 2 millions de dollars par an, est considéré comme une solution nécessaire pour endiguer le braconnage. Toutefois, une réduction de cette présence militaire en 2018 a entraîné une recrudescence du braconnage, illustrant toute la fragilité de cette approche.

◆ Une répression similaire dans d’autres pays
Le Nigeria adopte une stratégie comparable dans le parc national de Gashaka Gumti, où le gouvernement encourage une répression accrue contre les braconniers et les exploitants miniers illégaux. Des ONG comme African Nature Investors (ANI) collaborent avec le National Park Service (NPS) américain pour renforcer les moyens de surveillance, avec le recrutement de nombreux écogardes.
◆ Les populations autochtones en première ligne
Derrière ces initiatives de conservation se cache une réalité complexe : les populations autochtones sont souvent perçues comme des obstacles à la préservation des parcs naturels et sont régulièrement expulsées de leurs terres ancestrales. En République Démocratique du Congo (RDC), les Batwa ont été violemment dépossédés de leurs territoires dans le parc national de Kahuzi-Biega. En juillet 2024, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a finalement reconnu leurs droits en appelant le gouvernement congolais à leur restituer ces terres. Des abus graves ont été documentés dans ces parcs militarisés : meurtres, tortures, viols collectifs, décapitations et destruction de villages. En 2019, des enquêtes ont mis en évidence des exactions commises par des écogardes dans le parc national de Salonga, géré par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Ces abus ont même conduit à des enquêtes officielles aux États-Unis et à l’adoption de nouvelles législations, bien que les violences persistent.
◆ Une approche à repenser
Même si elles ont des objectifs compréhensibles, les stratégies actuelles de conservation ignorent souvent les problèmes structurels qui sont à l’origine du braconnage et de la déforestation. Aussi, la protection de l’environnement ne devrait pas se faire au détriment des populations autochtones, qui sont historiquement les premiers gardiens de ces écosystèmes. Plutôt que de militariser la conservation, une approche intelligente, impliquant les communautés locales, permettrait certainement d’obtenir des résultats plus durables tout en respectant les droits humains.
La COP16 a récemment mis en avant l’objectif « 30×30 », visant à protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030.
Si cette politique n’intègre pas les populations locales dans ses plans, elle risque d’exacerber les tensions et les injustices au lieu de préserver véritablement la biodiversité ! La notion même de braconnage est une construction colonialiste qui criminalise les pratiques de subsistance et les savoirs écologiques autochtones au profit d’une vision occidentale de la conservation, alors que les peuples autochtones savent exactement comment pratiquer la chasse et la pêche en conscience, en respectant les équilibres naturels et en régulant les prélèvements pour assurer la pérennité des écosystèmes.
« Les peuples autochtones ne voient pas la nature comme une marchandise à exploiter, mais comme une communauté à laquelle ils appartiennent », Vandana Shiva
Jessica Baucher avec Courrier international
* Crédit photo en tête d’article : ©Pixabay






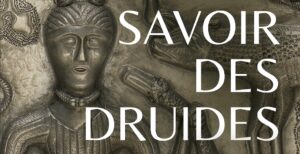
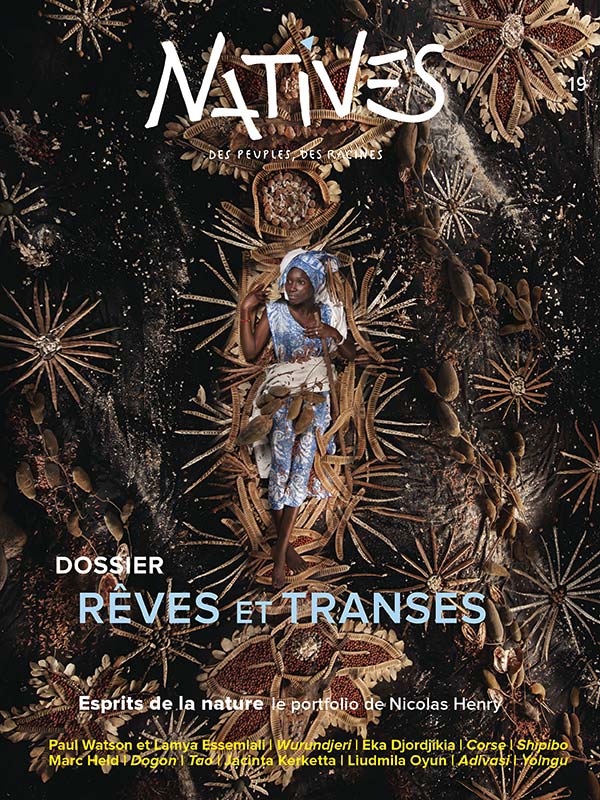
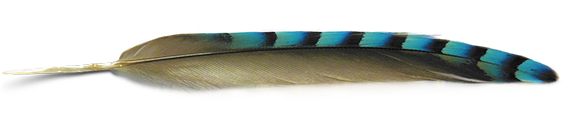



No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.