La COP30, qui s’est tenue du 10 au 22 novembre 2025 à Belém, en Amazonie brésilienne, se voulait la « COP des peuples autochtones ». Pourtant, malgré une forte mobilisation et une visibilité inédite des communautés concernées – dont des leaders emblématiques comme Raoni Metuktire – la conférence a été marquée par des incidents, des tensions et des revendications fortes restées largement insatisfaites. Entre espoirs, affrontements et déceptions, ce sommet révèle les contradictions persistantes entre discours, promesses et réalités de terrain…
◆ Un sommet historique… sur le papier
Organisé en Amazonie, dans un pays emblématique des luttes autochtones et de la préservation forestière, la COP30 a attiré un nombre record de représentants des peuples autochtones : selon les autorités brésiliennes, plus de 900 personnes autochtones étaient présentes… un véritable bond par rapport aux précédents sommet. Celui-ci a vu la création d’un village autochtone éphémère à Belém, surnommé Aldeia COP, qui a permis à des communautés du Brésil et d’ailleurs de faire entendre leurs cultures, revendications et visions du climat. Plusieurs événements officiels comme des conférences, tables rondes, panels, ont mis en valeur le rôle des peuples autochtones dans la gestion des forêts, la biodiversité et la lutte climatique. Ces aspects symboliques ont été perçus par beaucoup comme une reconnaissance historique de l’importance des communautés autochtones dans la lutte contre la crise climatique.

◆ Exclusion des décisions
Malgré cette forte visibilité, de nombreuses voix autochtones et associatives ont dénoncé un fossé entre la scène médiatique et l’accès réel au pouvoir de décision. Une coalition d’organisations autochtones a publié une déclaration cinglante sous le titre « There is No ‘Indigenous COP’ Without Affirming the Rights of Indigenous Peoples Across All COP30 Decisions ». Ils réclamaient la reconnaissance pleine et entière de leurs droits : droits fonciers, participation libre et informée, pouvoir de veto sur les projets affectant leurs territoires. Pourtant, malgré le nombre élevé de participants autochtones, beaucoup se sont dits exclus des négociations clés. Plusieurs représentants ont exprimé le sentiment que leur rôle restait purement symbolique. Des projets majeurs menaçant les territoires comme l’exploitation pétrolière, des projets d’infrastructures, l’expansion de l’agrobusiness, l’exploitation minière, n’ont pas été remis en cause dans les accords finaux, malgré les fortes protestations. Ainsi, pour bon nombre d’autochtones présents, la COP30 a donné l’impression d’un « vernis indigène » : beaucoup de visibilité, mais peu de pouvoir effectif.
◆ La colère autochtone
Plutôt que de se contenter d’être observateurs, plusieurs groupes autochtones ont manifesté leur impatience, voire leur colère, face à ce qu’ils jugent un manque d’action et de respect. Le 12 novembre dernier, des dizaines de manifestants, en majorité autochtones, ont forcé l’entrée du site de COP30, provoquant des heurts avec les agents de sécurité. Un porte-parole des Nations unies a déclaré que le site avait subi “des dommages mineurs”. Ce blocage visait à réclamer une audience avec le président brésilien Lula da Silva, afin de dénoncer les projets d’aménagement et d’exploitation des territoires menaçant la forêt et leurs modes de vie. Selon les manifestants : « Our forest is not for sale » (notre forêt n’est pas à vendre). En réaction, la sécurité autour de la conférence a été drastiquement renforcée : milices, police, forces armées ont été déployées massivement, ce qui a suscité de vives critiques. Dans une lettre ouverte, 201 organisations ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une « militarisation » et une tentative de « faire taire » les défenseurs autochtones du climat. Pour beaucoup d’observateurs, la présence massive de lobbyistes des industries fossiles à la COP – lobbying dénoncé comme l’un des obstacles majeurs à des engagements forts – illustre les limites du “verdissement” symbolique de la conférence. Les incidents montrent que, pour de nombreux autochtones, la COP30 n’a pas été qu’une tribune : c’était un espace de lutte et de résistance, là où le pacte entre climat, justice et droits humains vacille.

◆ De maigres avancées au regard des enjeux
Malgré les blocages, les protestations, et les frustrations, la COP30 a produit quelques résultats reconnus comme partiellement positifs. L’un des rares éléments salués a été l’engagement à développer un “mécanisme de transition juste” (Just Transition Mechanism), visant à coordonner les efforts de sortie des énergies fossiles tout en protégeant les droits des travailleurs, des communautés affectées, et notamment des peuples autochtones. Plusieurs voix parmi lesquelles des ONG, ont reconnu que le ” pouvoir citoyen”, et notamment celui des peuples autochtones, a joué un rôle déterminant pour obtenir cet engagement. Par ailleurs, la conférence a permis de donner une visibilité sans précédent aux revendications autochtones – des droits fonciers à la reconnaissance des savoirs traditionnels – ce qui, on l’espère, pourrait peser sur les COP à venir. Cependant, ces avancées restent largement insuffisantes pour répondre à l’urgence des crises climatiques, écologiques et des droits des peuples autochtones.
La COP30 restera peut-être comme la COP la plus “indigène” de l’histoire : en nombre de participants, en visibilité, en symboles. Cependant ce sommet a mis en lumière, une fois de plus, les limites profondes du modèle de gouvernance climatique mondial : la reconnaissance médiatique ne suffit pas ! Tant que les peuples autochtones ne seront pas associés aux décisions et n’auront pas un pouvoir réel et des garanties sur leurs droits fonciers, culturels… Toute annonce restera fragile. La colère, les incidents et les protestations montrés à Belém rappellent que ces communautés ne sont pas de simples figurants : elles sont les premières victimes de la déforestation, de l’exploitation des ressources naturelles, et des impacts du changement climatique. Ignorer leurs revendications serait non seulement injuste, mais suicidaire pour la planète…
« Il n’y aura pas de “COP indigène” sans l’affirmation effective des droits des peuples autochtones »,
Collectif autochtone à la COP30
Jessica Baucher
+ Crédit photo en-tête d’article : ©Pixabay







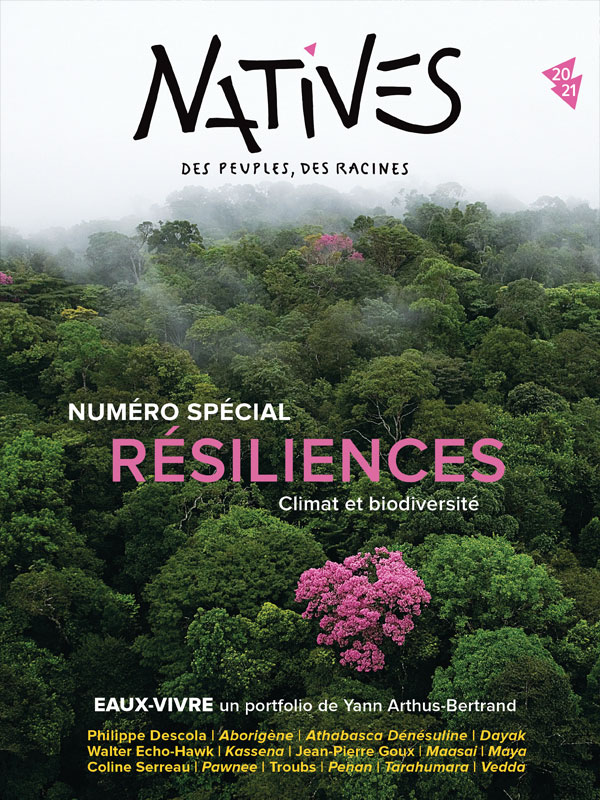
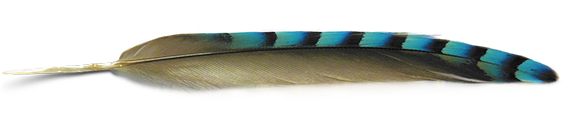



No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.