Près du village de Gourmel, au nord du Sénégal, nous avons rencontré des communautés peules nomades. Nous sommes dans la région sahélienne de l’ancien royaume du Fouta Toro qui longe le fleuve Sénégal. Là vivent les derniers Peuls nomades « Mbororo », restés fidèles au nomadisme pastoral.
Les Peuls (aussi appelés Fulbe) sont l’un des peuples les plus anciens et les plus étendus d’Afrique de l’Ouest. Leur origine est vraisemblablement à chercher chez les « pasteurs à bovidés » du Sahara préhistorique, dont on peut encore voir le mode de vie dans les peintures rupestres du Tassili et qui ressemble étonnamment à celui des Peuls nomades d’aujourd’hui. Selon Pierre Francis Lacroix, professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales de l’université de Paris-III : « Malgré l’absence de documents, il semble que leur « ethnie » se soit constituée au cours du haut Moyen Âge, dans la vallée du Sénégal et les régions adjacentes de l’Est et du Nord-Est, par apports de populations berbères et surtout noires à cette souche originelle. C’est en tout cas de ces dernières que provient, dans ses structures essentielles, la langue peule, qui appartient au même ensemble que le wolof et le serer-sin, parlés dans la République du Sénégal. » Des « études génétiques et linguistiques situent leur berceau à l’extrémité ouest du continent, autour de la vallée du fleuve Sénégal », confirme Dougoukolo Ba-Konaré, enseignant en civilisation peule à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), à Paris.
Certains Peuls se sédentarisent peu à peu ou pratiquent un semi-nomadisme, notamment pour permettre à leurs enfants d’aller à l’école ou accéder aux soins, mais plusieurs clans continuent de pratiquer l’élevage nomade. À Gourmel, les nomades peuls que nous avons rencontrés vivent principalement de l’élevage transhumant, en particulier de bovins zébus, mais aussi de chèvres et de moutons. Leur mode de vie est profondément lié aux saisons : ils se déplacent à la recherche de pâturages pendant la saison sèche, avant de revenir vers les villages pendant la saison des pluies (juillet, août, septembre). Mais en saison sèche, les températures dépassent régulièrement 45 °C. Le réchauffement climatique provoque de plus en plus des sécheresses prolongées, un manque de pâturages. Les éleveurs se rapprochent alors des villages et des zones où on trouve de l’eau et il n’est pas rare que les animaux fassent des incursions sur les cultures irriguées, ce qui ravive les conflits séculaires entre éleveurs nomades et agriculteurs.

◆ La vache, élément central de la culture peule
La vache zébu, aux cornes en forme de lyre, est le personnage central de la légende peule. Selon des croyances anté-islamiques, l’univers a été créé à partir d’une goutte de lait. Et Gero, leur dieu mythologique, a conçu les Peuls comme les « jumeaux humains » des bovidés. Même les Peuls devenus sédentaires véhiculent dans leur mémoire et leur iconographie l’image de leurs ancêtres conduisant des troupeaux de pâturage en pâturage. C’est la vache qui fonde le statut existentiel du Peul, qui donne sens à son passage sur la terre et qui construit sa vie. La vache est perçue comme le plus digne des animaux domestiques. Les Peuls se considèrent d’ailleurs comme les plus compétents parmi tous les éleveurs pour lui fournir les meilleurs soins. Bien plus qu’une richesse économique, le troupeau représente l’identité, le prestige et la spiritualité. Chaque animal est connu par son nom, son lignage, ses caractéristiques. « Si un veau meugle, je sais lequel c’est, je vais le voir ; je le connais comme mon enfant », dit le pasteur Aliou. Chaque vache porte un nom et sa généalogie est connue sur plusieurs générations. Et lorsqu’un enfant nait, le clan lui offre une génisse.

◆ Les Peuls de Gourmel : un mode de vie ancestral
À Gourmel, les campements peuls sont constitués de huttes légères en paille, facilement démontables. Elles sont construites exclusivement par les femmes. Leur structure est faite de poteaux en bois de fromager ou de caïlcedrat, des bois très durs résistants aux attaques d’insectes. Puis recouvertes de branches de palmier et de typha australis, un roseau à croissance rapide qui colonise les rives du Sénégal. Les animaux sont parqués dans des enclos entourés de branchages d’acacias. L’organisation sociale des campements est très structurée, avec des chefs de clan, à qui tout visiteur s’adresse en premier, et une forte hiérarchie familiale. Les femmes jouent un rôle central dans la gestion du camp et de la famille. Dès leur plus jeune âge, les enfants peuls participent à la garde des troupeaux. C’est une tâche essentielle et quasi initiatique dans la culture peule. Ce mode de vie rend difficile l’inscription régulière des enfants à l’école. Même s’il existe des écoles dans les villages comme Gourmel, les enfants peuvent être à des dizaines de kilomètres quand la famille est en transhumance. Aller à l’école signifie souvent délaisser leurs responsabilités vis-à-vis des troupeaux et est encore mal mal vu par les anciens, voire perçu comme un abandon des traditions. La scolarisation est souvent perçue comme une distraction, comparé aux responsabilités immédiates du quotidien. Les tâches des enfants, comme celles des adultes, sont genrées : les garçons gardent les troupeaux et les filles aident à la traite, à la cuisine, à la collecte du bois ou de l’eau. Le lait reste l’aliment de base, complété par du riz et d’autres céréales comme le mil achetées au marché. On ne mange de la viande qu’à l’occasion des grands événements : naissance, circoncision, mariage…

◆ Barrière linguistique et culturelle
L’école n’est pas obligatoire au Sénégal et pour des familles nomades, le système scolaire classique n’est pas adapté. Les cours sont dispensés dans la langue nationale, le wolof, et ensuite en français, deux langues que les enfants ne parlent pas à la maison. Leur langue maternelle est le pulaar, et cela crée un fossé linguistique et culturel. De plus, les méthodes pédagogiques classiques ne prennent pas en compte la culture peule. La plupart des nomades, surtout les plus âgés, ne voient pas toujours l’utilité immédiate de l’école. Pour eux, l’apprentissage se fait par la transmission orale, les récits, la pratique de l’élevage, et la vie communautaire. L’école occidentale est souvent perçue comme une menace pour leur identité. « Certaines familles peules, surtout les plus traditionnelles, craignent que l’école éloigne leurs enfants de leur langue, de leur culture, ou de leur religion », explique notre guide. Pourtant, des solutions émergent lentement. Des ONG, des associations locales et parfois même l’État sénégalais ont mis en place des initiatives comme des écoles mobiles ou pastorales (qui suivent les familles dans leur transhumance), des programmes en pulaar, des écoles semi-nomades avec internat partiel. Reste que ces initiatives sont encore insuffisantes ou localisées.

◆ Culture, langue et traditions
Les Peuls parlent le pulaar, une langue douce et musicale. À Gourmel comme ailleurs dans le Fouta, les traditions orales sont très vivantes : chants pastoraux, contes et poèmes sont transmis de génération en génération. La musique peule, souvent accompagnée de flûtes ou de tambours calebasses, évoque la nature, les troupeaux et l’amour. La majorité des Peuls — y compris les nomades — sont musulmans. Depuis plusieurs siècles, l’islam s’est profondément enraciné chez les Peuls, notamment sous l’influence des grands empires et royaumes théocratiques du Fouta Toro, du Macina ou du Sokoto. La religion musulmane, surtout dans sa forme soufie, est très présente dans leur quotidien : ils prient cinq fois par jour, suivent le jeûne du Ramadan et apprennent par cœur certains versets du Coran. Mais des traces de spiritualités préislamiques persistent. Avant l’islamisation (qui a commencé entre le 11e et le 18e siècle selon les régions), les Peuls avaient des croyances animistes : ils vénéraient les esprits de la nature, les ancêtres, les forêts, les rivières, etc. Chez les nomades, on observe encore une cohabitation entre l’islam et les anciens rites, même si cela reste discret, parfois secret. Et même si aujourd’hui ils se déclarent musulmans, certains rites, tabous ou symboles d’origine animiste perdurent, souvent intégrés de manière discrète dans leur vie religieuse. Nombreux sont ceux qui portent des objets protecteurs autour du cou comme des gris-gris (« téré » en wolof) ou des talismans, censés les protéger contre le mauvais œil ou porter chance. On rencontre aussi des croyances aux djinns ou selon lesquelles les éléments naturels sont animés d’un esprit. Ce syncrétisme est une forme d’adaptation culturelle : une manière de rester fidèle à une foi tout en gardant le lien avec un monde invisible, ancestral et toujours vivant dans l’imaginaire. « Les Sénégalais sont à 90 % musulmans, mais à 100 % animistes », plaisante notre guide. Et selon un dicton peul : « On peut marcher vers demain, … mais il faut toujours connaître le chemin d’hier ».
Brigitte Postel
+ Crédit photo en-tête d’article : ©Brigitte Postel



 Abonnement 1 an
Abonnement 1 an

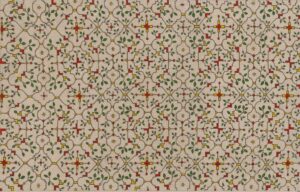


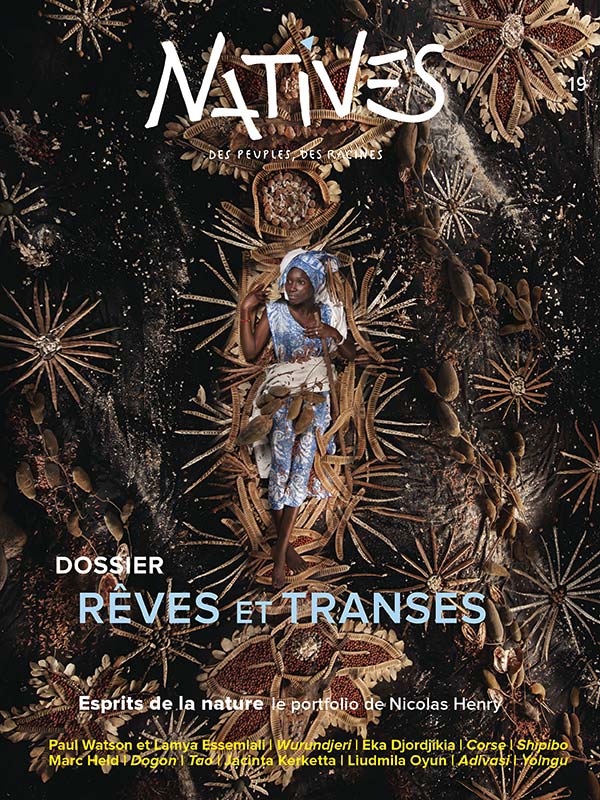
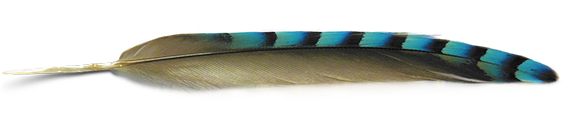


No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.