Le peuple Maxakali est un groupe autochtone vivant principalement dans l’État de Minas Gerais au Brésil. Depuis les années 2010, les Maxakali mènent des projets de reforestation communautaire pour restaurer la forêt atlantique dont il ne reste plus que 24 % de la superficie d’origine dans le pays. Une trentaine de personnes de la communauté sont en cours de formation à l’agroforesterie avec le soutien de l’équipe de chercheurs de l’Institut privé Opaoka, grâce à un financement public de 8 millions de reais (1,24 million d’euros).
◆ Qui sont les Maxakali ?
La population Maxakali est estimée à quelque 2 500 personnes. Ils parlent le maxakali, une langue de la famille des langues Macro-Jê, une des grandes familles linguistiques autochtones du Brésil. Bien qu’isolée dans sa branche (elle ne possède pas de langues apparentées parmi celles encore parlées aujourd’hui), cette langue est toujours vivante et transmise aux enfants. Les Maxakali sont connus pour avoir conservé des aspects très riches de leur culture traditionnelle, malgré les pressions de la société dominante brésilienne. Ils ont une relation très spirituelle et symbiotique avec la nature. Leur mode de vie est intimement lié à la forêt, aux rivières et à un panthéon d’esprits présents dans leur quotidien à travers chants, rituels et récits mythologiques. Ces esprits sont souvent associés à des animaux ou à des éléments naturels. Malheureusement, leur territoire traditionnel a été en grande partie réduit ou dégradé par l’exploitation agricole, la déforestation et l’expansion des villes. La forêt atlantique (Mata Atlântica), un écosystème complexe de forêts tropicales, d’arbres feuillus côtiers et de mangroves, recouvrait autrefois le territoire Maxakali. Sa couverture végétale dense retenait l’humidité et faisait de cette région l’une des plus riches en biodiversité au monde. Mais la destruction progressive de la Mata Atlântica a mis en danger la sécurité alimentaire des peuples autochtones, entrainé une perte de savoirs ancestraux et accentué les effets locaux du changement climatique – et, avec elle, les risques d’incendies de forêt. D’où tout l’intérêt des actions menées par l’Institut Opaoka.

◆ Projet Hãmhi – Terra Viva
Depuis son lancement en 2023, le projet Hãmhi – Terra Viva s’est imposé comme une initiative majeure de reforestation communautaire et d’agroécologie autochtone dans la région du Vale do Mucuri, au nord-est du Minas Gerais. Il est mené par l’Institut Opaoká en partenariat avec en collaboration avec le Ministère Public du Minas Gerais, l’Institut Estadual de Florestas, l’Université Fédérale de Minas Gerais, le collectif SementeMG, le Teia dos Povos (réseau de peuples traditionnels) et plusieurs ONG. L’institut a géré la formation de 30 agents agroforestiers indigènes Tikmu’un, chargés de la mise en place et de la gestion de jardins agroforestiers, ainsi que de la reforestation de 300 hectares sur les quelque 6 500 que compte leur territoire. L’objectif du projet est double : restaurer la forêt atlantique dégradée (l’un des biomes les plus menacés du Brésil) et revitaliser les liens spirituels, alimentaires et culturels entre les Maxakali et leur territoire ancestral.
◆ Des résultats concrets
Un premier bilan a été publié dans un Rapport de mai 2025. Il met en évidence plusieurs actions : 112000 plants d’arbres plantés, 60 ha de jardins agroforestiers installés dans les villages, intégrant cultures vivrières et arbres, création de trois pépinières-écoles et 26 pépinières familiales. 155 ha de forêts ont été restaurés par plantation d’espèces indigènes (plantes rituelles, fruitiers, plantes médicinales). En outre, le projet s’appuie sur une conception sacrée du territoire : chaque plante, arbre ou rivière abrite un esprit. Des chants rituels accompagnent les semis et les récoltes, consolidant ainsi le lien entre écologie et spiritualité. Les jardins agroforestiers intègrent également les espèces essentielles aux rituels et cérémonies. De plus, les enfants participent aux activités, ce qui permet la transmission intergénérationnelle.
En outre, le projet s’appuie sur une conception sacrée du territoire : chaque plante, arbre ou rivière abrite un esprit. Des chants rituels accompagnent les semis et les récoltes, consolidant ainsi le lien entre écologie et spiritualité. Les jardins agroforestiers intègrent également les espèces essentielles aux rituels et cérémonies. De plus, les enfants participent aux activités, ce qui permet la transmission
intergénérationnelle.

En associant les savoirs traditionnels aux principes de l’agroécologie, ces actions contribuent à la production alimentaire, à la formation de réseaux de collecteurs de semences, à la conservation et à la protection des forêts. Ils participent également à la création de pépinières éducatives et au renforcement des pratiques communautaires d’éducation à l’environnement et de développement autochtone. Le projet sert de modèle reproductible pour d’autres communautés autochtones au Brésil. Il démontre que la reforestation peut être un acte culturel, écologique et politique, enraciné dans la souveraineté territoriale. En plus de renforcer l’autonomie alimentaire de la communauté, ces projets permettent de revitaliser une identité en harmonie avec la forêt, et de résister à l’assimilation forcée en préservant la biodiversité sacrée pour les rituels des Maxakali.
Brigitte Postel
* Crédit photo en tête d’article : ©Pixabay



 Abonnement 1 an
Abonnement 1 an

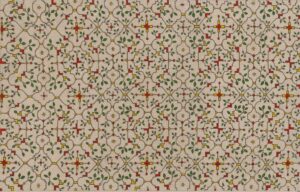


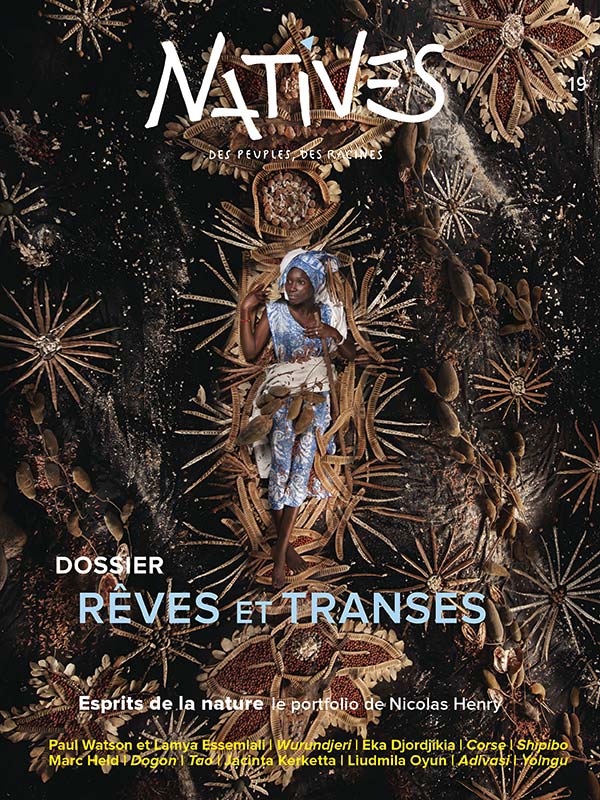
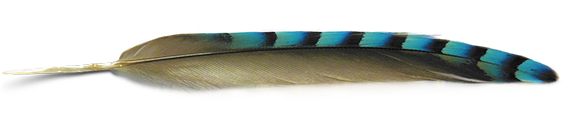


No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.